Marie-Claude Cotting Jean Steinauer
Café des Chemins de fer
Récit
![]()
B E R N A R D C A M P I C H E E D I T E U R
CET OUVRAGE EST PUBLIÉ AVEC L’APPUI
DE LA COMMISSION CANTONALE VAUDOISE DES AFFAIRES CULTURELLES
![]()
L’ÉDITION DE CET OUVRAGE A BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE À LA PUBLICATION ACCORDÉE PAR LES AFFAIRES CULTURELLES DU CANTON DE FRIBOURG
![]()
L’ÉDITION DE CET OUVRAGE A BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE À LA PUBLICATION ACCORDÉE PAR LA VILLE DE FRIBOURG
![]()
« CAFÉ DES CHEMINS DE FER »,
QUATRE CENT VINGT-DEUXIÈME OUVRAGE PUBLIÉ PAR BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR, A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LA COLLABORATION
DE JANINE GOUMAZ ET DE DANIELA SPRING MISE EN PAGES ET COUVERTURE : BERNARD CAMPICHE
DOCUMENT DE COUVERTURE : © ALAIN WICHT, LA LIBERTÉ,
PHOTOGRAPHIE, FORMAT 13 X 18 CM, DÉTAIL
PHOTOGRAPHIE DES AUTEURS : © CHARLY RAPPO, DÉTAIL, 2020 PHOTOGRAVURE : CÉDRIC LAUBER, L-X-IR IMAGES, PRILLY IMPRESSION ET RELIURE : IMPRIMERIE LA SOURCE D’OR,
À RIOM
(OUVRAGE IMPRIMÉ EN FRANCE)
ISBN 978-2-88241-460-1 TOUS DROITS RÉSERVÉS
© 2020 BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR GRAND-RUE 26 – CH-1350 ORBE
LES NOTES FIGURENT EN FIN DE VOLUME, PAGE 124
MISE EN PLACE
Le matin, avant l’ouverture, patron et personnel s’activent au buffet. Tout préparer pour les cafés : le sucre, trois morceaux dans une coupelle de verre, et la crème dans de minuscules pots de porcelaine, blancs au-dedans, bruns au-dehors, car les dosettes de plastique à opercule publicitaire n’existent pas encore. La pomme, alcool de paysan à quarante degrés, complément presque obligatoire à cette heure dans un bistrot fribourgeois, c’est à la cave que les filles du patron, Marie-Claude et Rachel (leur papa les appelle indifféremment Mimi), iront en chercher quatre litres à remplir, chaque matin. Aux Chemins de fer, il n’y a pas de percolateur italien rutilant. Marcel Cotting ne sert que du Nescafé, dans de grands verres à pied, une pure lavasse, mais il fait observer avec bon sens que « si tu ajoutes trois sucres, de la crème et de la pomme, le goût du café n’a plus d’importance ».
À midi et le soir, la mise en place est également d’une grande simplicité ; pas de nappes ni de sets, on ne fait pas de manières aux Chemins de fer, on posera les assiettes sur le bois ou le formica des tables. Il ne
— 3 —
s’agit que de tenir prêts couteaux, fourchettes et serviettes en papier, puis de répartir dans de petits godets la moutarde (Thomy bleue, en bidons de trois litres) qui accompagnera les saucisses de chien, spécialité proclamée de la maison. C’est du pur porc, évidemment, élaboré par la boucherie Poffet. Mais si les clients s’interrogent sur la composition réelle de la saucisse, Marcel oppose un silence hermétique. Et quand il n’y en a plus assez pour tout le monde, il s’excuse, d’un ton navré : « La semaine dernière, j’avais encore trouvé un saint-bernard, mais hier je n’ai rencontré qu’un basset. »
Et pour vous, ce sera quoi ? Une tranche d’histoire urbaine.
Celle d’un bistrot ouvrier dans un quartier qui l’est encore, mais qui hésite sur son avenir. Habita- tion ? Industrie ? Formation ?
Histoire d’un morceau de ville
Le quartier de Pérolles est né avec le XXe siècle autour du boulevard remblayé dont il porte le nom. Limité à l’ouest par le chemin de fer, il est bordé de l’autre côté par des pentes boisées tombant dans la Sarine. Aujourd’hui, colonisé par des écoles de tous genres et de tous niveaux, il s’organise au long d’une galerie de kebabs, burgers et cantines asiatiques. Mais à l’époque de ce récit, entre le boulevard et la voie ferrée, les fonctions résidentielle et industrielle dynamisaient un quartier mélangé.
La composante résidentielle rassemblait, sans trop de continuité dans l’espace, quatre types de constructions assez précisément datées, si bien qu’on
— 4 —
pouvait faire à travers Pérolles une sorte de promenade d’histoire architecturale. Aux extrémités du boulevard, la Belle Époque avait fixé des bornes repères, en l’espèce deux établissements prestigieux : face à la gare, le Grand Café Continental, annoncé par une somptueuse marquise de fer et de verre ; un kilomètre plus loin, le Casino des Charmettes, sis dans un jardin arboré. Jalonnaient l’intervalle quelques villas Heimatstil munies de ferronneries ondulantes et ornées de vitraux dans les cages d’escalier. L’entre-deux-guerres avait déposé en bordure du boulevard des immeubles locatifs sobrement imposants, influencés par le Neues Bauen et l’art déco, tel le paquebot blanc communément appelé « Moderna ». Mais la croissance de la population avait aussi doté le quartier d’ensembles de moindre qualité, parfois construits en fer à cheval autour d’une cour herbue, et grouillant d’enfants : le baby boom de l’après-guerre s’y observait à l’œil nu. La variété des habitats traduisant la diversité sociale, on peut dire que le Pérolles de ces années-là complétait sa population bourgeoise originelle d’une dense classe moyenne, sur un socle ouvrier résistant.
Car les usines s’y mêlaient encore aux habita- tions. L’industrie longeait assez logiquement la voie de chemin de fer et, plus on s’éloignait de la gare, plus elle devenait hégémonique. Les raisons sociales des entreprises, dans les propos quotidiens, obéissaient à un code familier ; on bossait au Cardoche (la Brasserie du Cardinal), aux Cartonnages (l’Industrielle ou Cafag). Le bistrot ralliait à heures fixes beaucoup de ces travailleurs – l’écriture inclusive n’est pas de mise ici, car les femmes ne fréquentaient pas les cafés, du moins pas seules.
— 5 —
Mais le Fribourg de l’immédiat après-guerre gardait une forte proximité avec le monde rural. Du côté de chez Marcel, les citadins retrouvaient sans effort le temps perdu de leurs grands-pères campagnards. On croisait autant de tracteurs que de camions. À moins de cent mètres du café, sur la droite, opérait le marchand de bétail Geissmann ; à la même distance, du côté opposé, s’étendait le champ de foire. Le café offrait à celui-ci une sorte d’annexe, petit terrain vague en bordure de rue où les éleveurs attachaient à une barre de fer les bovins qu’ils venaient d’acheter : les bonnes affaires, cela s’arrose, et des mauvaises on se console aussi devant un verre. Les paysans livraient des chars de patates à la Fédération des syndicats agricoles, qui les transformait en flocons pour le bétail. Ils repartaient avec un chargement de drèche, un résidu de brasserie complétant le fourrage des vaches. Et leurs femmes vendaient les œufs et légumes de la ferme au marché du quartier, à trois pas de là.
Pérolles possédait encore des espaces verts non jardinés, à commencer par une poche de nature qu’on n’ose pas dire préservée : le Grabe, un ravin tapissé de broussailles, enrichi de dépotoirs, hanté par les rats, qui faisait office de place de jeux. Dans ce paradis nauséabond tous les gosses du quartier ont mangé des grappes de sureau, cherché des trésors, combattu les Indiens, essayé d’embrasser leurs petit(e)s camarades et toussé en allumant une brindille de bois fumant. Mais l’urbanisation des années 1950 a comblé le Grabe, vigoureusement débroussaillé, assaini et dératisé au préalable. On y éleva, sur des pilotis de béton, le gros immeuble qu’on nomme toujours « La Ratière ». La nature se maintenait un tant soit peu à l’état sauvage sur les bords escarpés de la Sarine, bois
— 6 —
des Morts à l’ouest, lac de Pérolles à l’est. Le bois de Saint-Jean, où l’on pique-niquait en famille, faisait transition vers celui-ci.
Voilà, sommairement décrit, l’espace aimanté par le Café des Chemins de fer. Quant au cadre temporel de ce récit, on peut lui mettre des bornes élastiques : 1950-1970 environ. Avec cinq ans de plus au départ et cinq à l’arrivée, on s’inscrirait exactement dans les Trente Glorieuses occidentales, mais cette période d’expansion continue démarra, chez nous, un peu tardivement. Bref, l’après-guerre, et l’entrée dans la société de consommation.
Pour le canton de Fribourg, cette période marque bien plus qu’un tournant, un vrai bouleversement. Il est démographique, avec l’inversion du flux migratoire, qui se solde enfin par un bilan positif ; les maçons italiens arrivent désormais plus nombreux que les indigènes partant conduire un tram ou régler la circulation à Genève. Il est économique, avec un rattrapage industriel énergique. Il est politique, au bout du compte, avec la fin de l’hégémonie des conservateurs catholiques nostalgiques d’un canton agricole et d’un État clérical, paternaliste, autoritaire au besoin. Sur le plan culturel, c’est l’ouverture
– forcée : la télé arrivait dans les ménages ! – aux bruits du dehors, et l’aggiornamento du quotidien local ; en 1970, avec l’arrivée du rédacteur en chef François Gross, La Liberté devient un vrai journal.
Un roman d’apprentissage
Cette hâtive évocation du contexte, en perspective surplombante, ne suffit évidemment pas.
— 7 —
Le temps de l’histoire, c’est aussi du temps vécu, dans le cas présent celui de l’enfance et de l’adolescence pour les auteurs, un temps qui se déroule et se scande à un rythme individuel. Dans ce quartier de Pérolles où nous habitions à quelques pas seulement de distance, nous avons disposé d’une vingtaine d’an- nées pour intégrer, exactement : pour incorporer, le changement ambiant. En étions-nous vraiment conscients ? Nous grandissions dans un cadre familial pareillement clos, « sécurisant » en langage psy, malgré d’énormes différences de style. La truculence expansive de Marcel, de mise au café mais débordant sur les relations familiales, avait sans doute quelque chose d’exceptionnel pour une époque, un endroit et un milieu attachés au non-dit par souci des conve- nances. C’est pourquoi la relation de Marie-Claude à son père, qui structure le récit, lui confère une valeur mémorielle et des propriétés révélatrices particu- lières. Ce livre tient aussi, un peu, du roman d’ap- prentissage.
Mais le tricot serré d’anecdotes et de portraits qu’il contient compose bien un ouvrage d’histoire. Un de ses personnages, au moins, ne nous aurait pas disputé ce point. C’était un prêtre franciscain de l’Ordre des frères mineurs, ici appelés cordeliers. Ayant passé le gros de sa vie en Afrique, le Père Claude Cotting manifesta son amour de la ville natale en publiant une joyeuse pochade, illustrée de sa main, pour en conter les origines médiévales. Et de s’interroger sur l’âme de Fribourg : « C’est quoi ? Eh bien, c’est ce qui se cache derrière ces murs, ces ponts, ces tours, c’est l’histoire des êtres vivants 1 » qui ont façonné la cité. Loin de désapprouver son frère, Marcel aurait réclamé la suite.
— 8 —
Oui, mais la Méthode, objectez-vous, la Méthode historique, où est-elle passée ? Ne nous payons pas de mots. Elle revient finalement à se donner les meilleures garanties de ne pas tricher avec la vérité. Elle n’interdit nullement de laisser affleurer la mémoire et les affects : on ne fait pas de l’Histoire en laissant au vestiaire ses passions, ses émotions, ses convictions. S’il faut abandonner quelque chose en se mettant au travail, on rejettera plutôt les corsets conceptuels et les fanfreluches érudites. Nous ne rapportons ici que des faits vrais et des paroles attestées par un document ou plusieurs témoins, mais nous refusons d’occulter leur dimension proprement légendaire, ce « surplus de vérité » qui de nos jours encore abolit le temps et rapproche les gens. Nous n’avons jamais hésité à ressusciter l’univers subjectif de nos jeunes années pour construire un morceau d’histoire urbaine digne de validation.
D’ailleurs, nous pouvons invoquer de nobles cautions. Un très savant chercheur, dans un livre manifeste récent, invite l’historien à « donner du plaisir, mais aussi en prendre », par exemple en se laissant motiver par les sentiments et les souvenirs d’enfance : « Écris le livre de ta vie, celui qui t’aidera à comprendre qui tu es. Le reste suivra : rigueur, hon- nêteté, excitation, rythme 2. » Et si toutes ces précau- tions oratoires ne vous suffisent pas, allez boire un verre à la santé d’un des plus grands médiévistes de notre temps – non, pas Claude Cotting, mais Georges Duby. « Ne nous méprenons pas, écrit-il, la fonction du discours historique a toujours été de divertir 3 ».
— 9 —
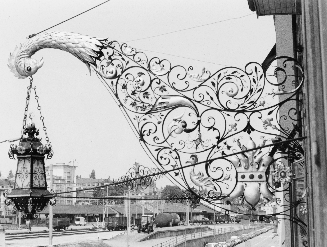
L’enseigne de Roger Monney
Collection particulière, détail
CHAPITRE 1
LA MAISON
Tout a changé d’échelle sur le site et ses alen- tours. Seul un archéologue pourrait aujourd’hui en reconstituer le plan au milieu du XXe siècle. Comment imaginer le modeste gabarit des constructions, quand au lieu de la baraque de planches à l’enseigne de Vuichard Cycles s’élève une tour de douze étages ? Un monstre immobilier aux structures de métal peintes en bleu a englouti le Café des Chemins de fer. Comment deviner que dans son ombre subsistent, cachées au regard, les petites maisons du Champ-des-Cibles ? L’îlot portait ce nom parce que bâti à l’extrémité d’une ancienne ligne de tir, le stand étant situé à la distance réglementaire de trois cents mètres sur le boulevard de Pérol- les fraîchement construit.
Remontons dans le temps, d’un bon siècle. Le café occupe une petite maison en contrebas de la Brasserie du Cardinal, l’ancien propriétaire devenu fournisseur numéro un, comme si la gravitation conduisait naturellement la bière de l’usine au Café des Chemins de fer et jusque dans le gosier des clients. Ces flots de bibine supposent d’assez
— 11 —
nombreux consommateurs. Ils sont là depuis la construction d’un pâté de maisons, entre 1890 et 1900. Le Champ-des-Cibles aligne « une rangée d’habitations ouvrières (…) au débouché du passage sous la digue du chemin de fer 4 », le passage du Cardinal, justement. Pas d’architecture Heimatstil ici, pas même d’architecture du tout, c’est le degré zéro de l’urbanisation – des entrepreneurs qui élèvent deux étages sur rez, sans faire de chichi sur les façades ni recourir à des matériaux chers. Il ne s’agit que de loger les travailleurs au voisinage immédiat des usines : une fabrique d’engrais chimiques, une de fourneaux, une de caisses, et bien sûr la brasserie, toutes en bordure des rails.
Le Café des Chemins de fer, à l’origine, ne se distingue guère du lot, c’est une maison ouvrière avec, peut-être, des ateliers au rez-de-chaussée ; après une première transformation, en 1905, il devient le Café Stern. Vingt ans après les premières construc- tions, le Champ-des-Cibles et l’espace qui le relie au boulevard commencent à prendre forme, parce que la voirie s’ordonne à angles droits conformément à la planification initiale, et ce quadrillage routier appelle la construction d’immeubles de rapport qui vont densifier le secteur central de Pérolles. Mais en 1920, le Champ-des-Cibles ne compte que vingt et une maisons abritant quatre-vingt-deux ménages, qui totalisent trois cent quatre-vingt-cinq âmes.
Les Cotting peuvent arriver sur le site.
C’est Louis qui débarque, en 1923. Il achète la maison avec le bistrot. Ses amis ont beau le mettre en garde : « Trop loin de la gare ! Tu n’auras personne », le jeune professionnel qu’il est a détecté le potentiel d’un quartier en plein essor. À cette époque, les
— 12 —
cheminots traversent un pré pour aller boire leur verre, car la route des Arsenaux n’existe pas encore. Elle ne sera mise en chantier qu’en 1936, grâce aux fonds de lutte contre le chômage, et achevée qu’en 1941 pour faciliter l’accès à l’arsenal 5.
Jusque-là, donc, pas de circulation autour du café, sauf les courses de caisses à savon. L’aîné des fils de Louis a raconté qu’il possédait encore « une vieille photo rappelant l’arrivée du premier Grand Prix du Champ-des-Cibles, en 1925. Pour cette occasion, on avait réquisitionné toutes les roues de poussettes et brouettes du quartier et c’était pathétique de voir les mamans sortir avec leurs bébés et ne trouver que des poussettes sans roues. (…) Le premier recevait un sirop aux framboises, le second un bâton de bois doux et le troisième une sucette 6. »
Architecturalement, l’établissement de Louis Cotting est le moins remarquable des trois qui se partagent la clientèle de Pérolles. Passons sur le Café de l’Université, aujourd’hui Brasserie 39, comme son numéro sur le boulevard. Il vit de l’autre côté du Grabe, le ravin, au pied d’un bâtiment construit en 1897 pour le banquier Sallin ; autant dire qu’il en jette, aussi bien avec ses formes nobles, oriel et tourelle, qu’avec ses riches matériaux de couleur variée, sa couverture d’ardoise et ses ferronneries. Le Café du Simplon, tout proche des Chemins de fer, a été bâti vers 1910 pour la famille Livio dans une architecture assez pompeuse, avec dôme, oriel et tourelle, mais il épate moins. Si la clientèle est populaire, l’ambiance y est relativement morose ; au souvenir de Ronald Rossmann, mémorialiste du Champ-des-Cibles 7, cela tient au caractère taciturne des propriétaires, alors que chez les voisins, les
— 13 —
enjoués Louis puis Marcel Cotting, il y a toujours matière à rigolade.
La plus folle des enseignes
Le bâtiment des Chemins de fer dans son état d’origine, tel que l’achète Louis Cotting, est un simple cube de maçonnerie crépi de blanc, percé d’ouvertures banales, sous un toit de tuiles à deux pans. Le feuillage d’un tilleul et d’un marronnier, ombrageant le pignon sud, lui donne un petit air d’auberge de campagne. En un peu plus d’un quart de siècle, il va changer de forme, de structure et d’environnement pour acquérir la configuration qu’il aura, sous le règne de Marcel, jusqu’à sa démolition. Côté gare, un immeuble est venu se coller au café ; le rez-de-chaussée en est occupé par un atelier de mécanique, dans la tradition artisanale et industrielle du quartier. Du côté opposé, on agrandit la salle à boire et l’on coiffe cette extension, éclairée de larges baies, d’une terrasse où la patronne fait sécher son linge.
La surface commerciale se prolonge dans un jardin planté de marronniers qui a laissé un souvenir très romantique au cœur de nombreux citadins, amoureux se bécotant au clair de lune ou bambins jouant avec le gravier. À la belle saison Marcel pré- pare les caisses de séparation où le lierre grimpe le long de fils de fer, il change les planchettes abîmées des chaises, repeint en rouge sièges et tables et tend des guirlandes d’ampoules multicolores entre les arbres. Sur la façade côté voie ferrée, un double escalier conduit à la nouvelle entrée du café
— 14 —
(l’ancienne donnait sur la rue du Simplon), que surmontera la plus folle enseigne de toute la ville
– mais n’anticipons pas.
Vue en coupe, entre 1950 et 1970 la maison présente une stratigraphie clairement lisible. Sous le toit, un petit logement mansardé abrite des locataires. Le deuxième étage, celui de Louis Cotting et de sa femme Catherine, comprend un salon salle à manger et trois chambres, pour lui, pour elle (plus tard, Marcel en fera son bureau) et pour les garçons ; celle-ci deviendra une chambre de bonne. Au premier vivent Marcel, sa femme Marie et leurs deux filles ; soit une chambre pour les parents et une pour les Mimis, plus une pièce de cérémonie dite « la belle chambre » où rarement la famille vient dîner dans de la belle vaisselle, et une pièce à usages multiples mais où personne ne dort, curieusement dénommée « le musée ». À ces locaux s’ajoute une cuisine qui n’en a que le nom. En fait, c’est la salle d’eau, exiguë, non chauffée, munie d’une douche et d’une minuscule baignoire dans une sorte d’alcôve à l’usage exclusif de Marcel, les filles utilisant pour leur toilette quoti- dienne une cuvette de fer-blanc. Au rez-de-chaussée, un corridor, la cuisine et la salle à boire, avec son extension et des toilettes modernes installées à la faveur de cet agrandissement. Tel apparaît le Café des Chemins de fer, ramené à ses traits physiques principaux, dans le souvenir de celles et ceux qui l’ont fait vivre à son âge d’or.
Mais un véritable monument installé en façade, sur la rue des Arsenaux, attire l’attention au point de cacher, ou presque, l’immeuble qu’il signale. L’en- seigne des Chemins de fer, c’est une histoire en soi dans l’histoire du bistrot. Marcel l’a commandée un
— 15 —
après-midi, devant un café pomme, à son ami ferron- nier Roger Monney, sans grand discours – ces deux-là se comprennent sans se parler, on dirait qu’ils s’en- tendent penser. Roger trace une volute au crayon sur un ticket de caisse, puis le vague dessin d’une lampe, la cause est entendue : il forgera une lanterne pendant au bec d’un coq au long col recourbé, le tout conve- nablement orné et doré. Quant au délai de livraison, il n’en est pas question. La réalisation de l’enseigne prend sept années, pas moins, pendant lesquelles Marcel monte souvent à Bellerive, dans le Vully, constater l’avancement (ou non) des travaux en trin- quant avec l’artiste dans son atelier. La livraison est mouvementée. Roger, venu à vélo, dort d’un sommeil très imbibé quand le camion arrive avec le monstre. La pose et l’ancrage nécessitent l’emploi d’un écha- faudage et d’un camion-grue. Le résultat, grandiose, n’est évidemment pas proportionné à la petite façade de la maison, et les passants admirent ce chef-d’œuvre d’artisanat en se demandant si le bâtiment qui le sup- porte va tenir le coup. On est en 1972.
Douze ans plus tard, quand les patrons mettent la clé sous la porte, des propositions d’achat pour l’en- seigne affluent de tout le pays, mais Marcel, intrai- table, a décidé que l’objet doit rester à Fribourg. Son ami le plombier Bernard Cotting en fait l’acquisition, le restaure et le place à l’angle d’une vaste maison qu’il possède au bas de la route des Alpes. Les formes luxuriantes de l’enseigne, ses dorures et son fer forgé conviennent parfaitement à cet édifice Heimatstil, où elle est admirée tous les jours et photographiée par les touristes du monde entier, planant sur le haut de la Grand-Fontaine, la rue chaude de la ville. Les indi- gènes, goguenards, commentent l’opportunité de
— 16 —
suspendre une tête de coq à l’entrée de la rue des poules. Quand Bernard Cotting vend la maison en 2003, la ville rachète l’enseigne qui désormais fait partie du patrimoine public.
Un intérieur trompeur
On pousse la porte du café, et face au comptoir on éprouve le premier choc. Il n’y a pas de percolateur ! Marcel n’en a jamais voulu, il n’en voudra jamais, professant qu’avec les ajouts nécessaires (beaucoup de sucre, un peu de crème, et de la pomme en suffisance) le Nescafé s’avale très bien – et ceux qui veulent du raffinement à l’italienne peuvent aller voir ailleurs. Un regard circulaire, et la deuxième surprise s’impose : il n’y a pas de juke-box non plus. Marcel enregistre son programme audio sur un magnéto- phone Revox, et qui veut écouter sa propre musique aux Chemins de fer amène sa bande et négocie avec le patron.
L’objet caractéristique du café, celui qui polarise l’espace, rayonne au fond du bistrot, sous un immense miroir au cadre doré, c’est le baby-foot ou football de table, appellation française contrôlée ; ici, on dit le
« zim-zim » ou le « fote-fote », l’objet étant trop usuel pour qu’on en prononce le nom à l’anglaise. Il faut que le meuble soit solide, car une génération après l’autre, à toutes les heures de la journée, les jeunes venus en bande se livrent des parties ferventes, les spectateurs supporters faisant bruyamment cercle autour des joueurs. On se défoule avec bonheur chez Marcel, qui apprécie le mouvement et ne s’évanouit pas devant un peu d’agitation. Le baby-foot attire
— 17 —
tous les jeunes, les garçons et les filles du quartier ou d’ailleurs, les apprentis et les étudiants de l’univer- sité, les gars du Tech’ (le Technicum cantonal est au fond de Pérolles) draguant les élèves infirmières qui débarquent après les cours. Certains de ces futurs ingénieurs ont habilement usiné une sorte de tringle qu’ils enfilent dans l’appareil, à la place de la pièce de quatre sous qui libère les balles. Il faut certes investir les premiers vingt centimes, mais les parties sui- vantes sont gratuites car la tringle empêche les boules de retomber dans la réserve, et les joueurs peuvent les récupérer indéfiniment. Mais le patron, mine de rien, a l’œil. Marcel s’approche du jeu et retire la tringle sans bruit, sans un mot. Si les jeunes, qui se regardent avec l’air de dire : « Essayé, pas pu ! », recommencent à jouer de la tringle, ce ne sera pas aux Chemins de fer.
Hors de la salle à boire, la maison réserve des mystères, des surprises et des merveilles propres à frapper l’imagination enfantine et à marquer la mémoire des filles du patron.
Après le décès de Catherine, Marcel a organisé son bureau dans la chambre de sa mère au deuxième étage. Personne n’a le droit d’y faire le ménage, et encore moins de penser à y mettre de l’ordre. Marcel s’en charge personnellement, après quelques discus- sions houleuses avec sa femme qui a fini par abandon- ner l’idée de nettoyer ou de ranger la pièce. Personne n’y entre, personne n’ose le déranger dans cette espèce de tour d’ivoire. Mais, pour les fillettes, c’est un endroit créatif et presque hors du temps. Elles seules sont autorisées à venir s’asseoir à la table du père, pour exécuter avec bonheur de petites tâches qu’il s’ingénie à inventer à leur intention, pour dessiner, ou
— 18 —
pour écrire avec sa plume Mont-Blanc, cadeau d’une paroissienne à son frère Claude. Elles ne touchent évi- demment pas aux piles de paperasse, car il sait exac- tement où se trouve le document dont il pourrait avoir besoin.
Une grosse machine à calculer, verte, avec de larges touches et un rouleau de papier, trône à droite de la table devant la fenêtre. Entre la calculation des salaires et des retenues pour l’AVS, les décomptes des stocks et les chiffres de la déclaration d’impôts, la machine chauffe en émettant un bruit infernal, et sur- tout elle produit des kilomètres de ruban de papier que Marcel contrôle consciencieusement puis déchire d’un coup sec et laisse tomber à terre, en évitant la grande corbeille que sa femme a pris soin de disposer à proximité de la table. De toute évidence, il fait exprès. Ces jolis rubans qui tire-bouchonnent joyeu- sement, ces volutes de papier blanc imprimé d’in- nombrables chiffres, et qui jonchent le sol, il faut les shooter pour poser le pied sur le parquet. Les fillettes apprennent très concrètement le sens de l’expression
« marcher sur des œufs ». Le privilège d’accéder à l’es- pace exclusif de ce père très spécial leur apporte un sentiment de bien-être dont elles ne comprendront la plénitude qu’à l’âge adulte.
La petite chambre, au premier étage, qui bien sûr ne sert jamais de chambre (comme cet intérieur est trompeur !) et que les petites appellent « le musée », renferme beaucoup de choses. Les unes sentent bon, d’autres pas, certaines n’ont pas d’odeur.
Sur de robustes étagères montant jusqu’au pla- fond s’empilent par centaines les boîtes de Nescafé, si hermétiquement fermées qu’elles ne dégagent mal- heureusement aucun parfum. Des tablards portent les
— 19 —
réserves de cigarettes – Parisiennes carrées, Marocaine super (« la cigarette du sportif », dit la publicité en ces temps pas bégueules), Stella filtra, Virginie, Marylong… Il faut grimper sur une chaise pour saisir les cartouches, à défaire ensuite pour introduire les paquets dans l’automate du café, au rez-de-chaussée. La réserve de cigares est conservée dans un meuble à tiroirs, comme un vaisselier où le tabac aurait rem- placé les assiettes ; ici, pas de havanes aux noms ronflants, mais des produits du pays, Rio 6 et Villi- ger, « truites » et « bouts », et les fermentés, longs brissagos et tortueux clous de cercueil. Tout ce tabac exhale un parfum un peu sucré, parfois recouvert par l’odeur du linge fraîchement repassé.
La lessive se fait en bas, à la cuisine, dans une machine Élida avec essorage intégré, la pointe de la modernité au début des années 1950 ! Mais on garde et entretient le textile au « musée ». L’armoire à linge contient à la fois les habits et les papiers de la famille ; le fusil militaire de Marcel est caché dessous (la munition, comme prescrit, se range à part – dans la table de nuit, à la chambre des parents). Il y a deux tables, une grande sur laquelle on étend une couver- ture et un drap pour le repassage, et une petite qui porte la machine à coudre de Marie, une Bernina Sport, verte. Les filles peuvent passer des heures à s’initier toutes seules à la couture. Elles disposent d’une corbeille remplie de chutes de tissus, de boîtes de fil de toutes les couleurs et de ciseaux en plusieurs tailles. Le paradis de la créativité pour elles, et pour leur mère le soulagement de ne pas les avoir dans les jambes.
— 20 —
La petite fille dans l’escalier
On a vu la maison de haut en bas, puis de bas en haut, mais comme toujours l’essentiel est caché. Pour un café, c’est la cave. Ici, elles sont plusieurs, en enfilade.
L’exploration commence par la cave à pinard, un algérie dénommé Oramir que Marcel achète par lots de deux mille litres. Sol en terre battue, odeur puissante. La deuxième cave, au fond cimenté, contient les caisses d’eaux minérales et de sodas. Elle complète la cave à bière, avec les fûts de bois pour le service à la pression, située naturellement sous le comptoir du bistrot, où l’on range aussi les caisses de spéciale.
Un jour Marcel, ayant constaté un vol, y installe une alarme sonnerie. Quand elle se déclenche, il descend surprendre les voleurs (ce seul nom terrifie les gamines) et remonte en sifflotant. Tu as fait quoi ? « Je leur ai dit qu’il ne fallait pas recommencer, et ils sont partis tranquillement. » Marcel se souvenait à coup sûr que, durant son apprentissage chez le confiseur Rychner, quand il devait aller chercher des provisions à la cave, le patron l’obligeait à chanter à pleine voix afin d’être sûr que l’apprenti ne mangeait rien.
La troisième cave, noire et moisie, est le royaume des araignées, un dépotoir fleurant la pomme pourrie, par- semé de dames-jeannes mal en point et de bidons rouillés. Quand l’aînée des filles Cotting, qui exerce aujourd’hui comme thérapeute par le toucher dans une optique de développement personnel (Ennéagramme), se revoit gamine dans l’escalier plongeant vers la cave, elle ne peut s’empêcher de tirer un parallèle entre cet univers sombre, encombré, mystérieux, parfois malsain, et l’inconscient de ses patients. Elle se dit qu’une enfance bistrotière forme à beaucoup de choses.
— 21 —

La pose de l’enseigne en 1972
Photo Pierre-François Bossy. Collection particulière, détail

Le café en 1935
Photo Prosper Macherel. Collection particulière, détail
CHAPITRE 2
LA MAISONNÉE COTTING
Imaginez le café en coupe et sans façade, comme une maison de poupée où chaque personnage est figé dans sa pose. Voici qu’ils s’animent, et qu’au fil des heures, leur va-et-vient et leurs rocades brouillent l’image. De l’ouverture au fîrabe, tout le monde passe un peu partout. Le bistrot, entreprise familiale, identifie lieu de vie et lieu de travail à l’instar d’une ferme agricole, mais de plus il conjugue dans le même espace un établissement public et un domicile privé. Aux Chemins de fer, les filles Cotting ne sont pour ainsi dire jamais seules avec leurs parents, même après le départ du dernier client, il y a toujours des sommelières autour, et cela ne facilite ni la spontanéité des rapports, ni l’intimité des échanges. D’autant que tout le monde bosse ! Pendant les vacances d’été seulement, les Mimis adolescentes jouiront du luxe absolu « d’être rien qu’entre nous », d’être en famille.
Encore faut-il s’entendre sur le mot. La famille Cotting ne correspond pas au modèle nucléaire courant. Elle réunit trois générations sous le même toit, et s’attache étroitement quelques personnes par d’autres liens que ceux du sang.
— 24 —
Trois générations sous le même toit
Le grand-père, c’est Louis. En chair et en os dans le café, ou en photo au-dessus du comptoir après sa mort, il sourit sous une moustache blanche et porte un bonnet appenzellois de velours noir brodé de fleurs multicolores. Il ne le quitte que pour dormir, tôt couché en chemise de nuit et bonnet de coton à pompon, un bandeau sur les yeux. Louis coud lui- même ses habits, qu’il suspend à des crochets fixés dans sa chambre, des habitudes peu courantes chez les hommes. Celui-ci pouvait être dur, mais pratiquait avec tendresse l’art d’être grand-père. Il fascinait les Mimis en leur racontant le naufrage du Titanic, et pour leur anniversaire il les invitait dans sa chambre tout illuminée de bougies.
Louis est né dans la limonade, son père déjà tenait le Café du Pafuet, un hameau de Praroman. Gamin, il n’avait pas dû rigoler tous les jours, si l’on prend au pied de la lettre le certificat d’austérité décerné à son père Fridolin dans une notice non signée, relevée par une main inconnue et transcrite ici exactement :
« Petti journale de Praroman du 12 avril 1890. Mon- sieur le Rv Curé, Pour vous parler de notre honorable sitoyent Mr Fridolin Cotting propriétaire et tenancier de la pinte du Pafuet. Par sa conduite iréprochable il est tres sévères dans sont établisement pour les paroles scandaleuses et chansons déshonètes et il tien une bonne Police régulière. Et jamais lon a vu un de ces enfants dans sont établisement et n’a jamai garder personne pendant les offices divin et toujours garder des sommelieres de bonne conduite. Il est très bon
— 25 —
avec les pauvres et en leur donnent a gagner en tra- vaillant a la campagne. Si touse etait aussi bon que lui le monde ne serai pas à plaindre, et il fait tout pour bien élevé sa famille. Nous nous sommes trouvé quelques foits dans sa pinte des jours d’œuvre et je demandai aprè lui, et il était dans les champs avec ces ouvrier. Quant on alait à Fribourg, lui en revenai déja, il ne s’entretenai jamai. »
Les certificats de Louis jalonnent un début de car- rière modeste. Son acte de mariage, en 1913, le qua- lifie de « garçon d’hôtel ». Il a quitté son village à vingt-cinq ans, muni d’une recommandation offi- cielle : « Le Conseil communal de Praroman, canton de Fribourg, déclare que Louis Cotting fils de Frido- lin, de Tinterin, a séjourné pendant environ vingt ans dans notre commune et que durant ce temps il a tou- jours eu une conduite morale et régulière de sorte qu’il mérite un témoignage avantageux. » Louis trouve à s’employer un an comme casserolier à l’Hôtel de la Cigogne (zum Storchen), à Bâle, dont le directeur s’affirme « satisfait de son travail et de son comporte- ment ». Cap sur le Mont-Pèlerin qui domine Vevey, pour trois ans et demi à l’Hôtel Belvédère en qualité de portier concierge. Attestation du directeur : « Je n’ai eu qu’à me louer de lui sous tous les rapports. D’une excellente conduite, très sobre et très honnête, je me fais un plaisir de le recommander ». Là-dessus, mariage et retour à Fribourg, où il prend en gérance le Café du Boulevard, rue de l’Hôpital. Mais l’atta- chement à la campagne natale reste fort, et Louis ne saurait se passer de ses moutons. Comme il ne peut les garder au café ou dans l’appartement à l’étage, il les place chez des amis dans les villages alentour, Cor- minboeuf, Chésopelloz, Givisiez, et prend son vélo
— 26 —
pour les visiter. En 1923, dix ans après son mariage, il achète le Café des Chemins de fer, alors Café Stern et propriété de la Brasserie du Cardinal.
Très intelligemment, Louis Cotting a pris sa retraite à cinquante-sept ans en laissant à son fils Mar- cel les rênes du commerce. Particulièrement vigousse, comme il a gardé l’habitude de se lever à l’aube il ouvre le bistrot, et sert les cafés pomme ou les bobi- nos du matin jusqu’à neuf heures, quand la somme- lière en titre le remplace. Grand bricoleur – chacun de ses outils, toujours bien rangés, est estampillé LC – il huile les portes qui grincent, remplace les vis qui coincent, repeint la barrière et mastique les fenêtres. Dans son temps libre, avec le photographe Marco Lorson, il grimpe au Cousimbert ou à la Berra, vagabonde autour du Lac Noir, sac au dos, fixant à tout va personnages et bâtiments, surtout les immeu- bles en construction, incendiés ou en passe d’être détruits. Tout Fribourg figure encore dans les albums de Louis. Il lit beaucoup. Parfois il emmène une des Mimis, sa petite main enfouie dans la sienne, à la ferme de Pérolles où coule un joli ruisseau, et lui apprend le nom des fleurs. Les berges sont couvertes de tussilages, qu’il appelle des taconnets.
La grand-mère, Catherine, est née Horner à Chésalles. Elle a neuf ans de moins que Louis. Tail- leuse de son métier, elle ne tarde pas à devenir une vraie patronne de café, du matin au soir ayant l’œil à tout.
Trente ou quarante ans plus tard, elle s’autorise un rythme plus relâché. Quand elle se réveille, vers neuf heures, elle commence par raconter des histoires, sans quitter son lit, à Mimi grimpée au deuxième étage. Puis toutes deux préparent méticuleusement la
— 27 —
monnaie pour le personnel. C’est leur petit boulot du matin. La gamine empile les pièces de dix, vingt et cinquante centimes, aligne celles de un, deux et cinq francs ; parfois on confectionne des rouleaux de mon- naie que Marcel ira porter à la poste. Catherine des- cend prendre son petit déjeuner à la cuisine du rez- de-chaussée, le cœur de la maison. Dans l’après-midi et la soirée, au bistrot, elle tape le carton avec sa cote- rie. Elle reste en salle jusqu’à la fermeture, sans mol- lir. Un beau soir, un client éméché trouve malin de redescendre les chaises à mesure que Catherine les hisse sur les tables pour balayer. Elle lui ordonne d’ar- rêter son manège. Le bougre persiste, ignorant le tempérament de la patronne. Alors Catherine se retourne et lui flanque un tel coup de balai sur le crâne que le bonhomme saigne, et que Marcel et Marie doivent le panser.
Hors du travail, Catherine est une grand-mère affectueuse, qui passe beaucoup de temps à jouer avec Marie-Claude et Rachel. Avant qu’elles aillent à l’école primaire, elle leur apprend à compter sur leurs doigts, en prêtant les siens pour que les gamines arri- vent jusqu’à vingt. Catherine a tricoté des milliers de chaussettes pour toute la famille, y compris les culottes bas beige ou gris souris des fillettes, ancêtre rugueux des collants. Quand elle ne tricote pas, elle raccommode. Elle meurt en 1963, trois ans avant son mari.
Louis et Catherine ont deux enfants, Pierre qui se fait prêtre (en religion, le Père Claude : c’est le nom sous lequel on en parlera désormais) et Marcel, qui reprend les Chemins de fer avec sa femme Marie. Le couple forme une équipe de choc. Il faut bien ça pour tenir un café. Marcel en est l’âme et le comptable.
— 28 —
Marie, aux multiples talents, tient avec maîtrise le rôle de la fée du logis.
D’abord, elle cuisine (fort bien) pour la famille et pour le personnel, midi et soir. La planification et l’organisation des nettoyages, la distribution des ordres et le choix des techniques lui incombent. C’est encore elle qui confectionne les rideaux, changés régulièrement, du bistrot et de l’appartement. Cou- turière de son premier métier, qu’elle avait adoré, portant avec élégance des vêtements taillés et cousus de sa main, elle habille également sa belle-mère et ses filles, qui garderont pour la vie le goût de la couture. Amène et souriante pour les clients du café, Marie est plutôt raide en famille. Strictement catho- lique, pour tout dire, avec une tendance rigoriste, sinon puritaine. Marcel, qui est allé goûter avec une Mimi dans un restaurant loin de la ville, se prend une leçon de morale : « Et en plein Carême, encore ! » Interdiction formelle, pour les adolescentes, de se faire les ongles ; il faut enlever le vernis avant le retour de promenade, pour éviter les remontrances. Et de la tenue au bistrot ! Les gens se mettent volon- tiers à danser, le soir ; quand Marie-Claude, adoles- cente, fait trois tours de valse avec un homme « d’au
moins vingt-cinq ans », Marie intervient sèchement.
Le couple connaîtra même dans sa retraite des épisodes qu’on dirait sortis d’une série télévisée. Par- tant en voyage, Marie confie à son époux une azalée qu’elle vient de recevoir. Marcel, ravi de se retrouver seul à la maison, promet de donner à la plante un peu d’eau tous les deux jours. Il l’oublie évidemment, si bien qu’après dix jours les fleurs fanées pendent lamentablement au bout des branches. La veille du retour de sa femme, il arrive de chez le fleuriste avec
— 29 —
une grande azalée enveloppée… de papier journal, emballage qu’il a expressément demandé. Pour éviter que les voisines, curieuses derrière leur fenêtre, ne disent au retour de Marie : « Vous avez de la chance, Madame Cotting, votre mari vous a fleurie ! »
Les deux filles du couple sont nées à quatre ans de distance. On se souvient du jour où l’aînée est venue au monde, et pas seulement parce que c’était celui de la foire aux taureaux, à deux pas du café. Mort de trouille à l’idée d’assister à la naissance, Marcel avait glissé dans la poche de son pantalon une topette de cognac. Au cours de l’accouchement la bouteille, pro- bablement mal bouchée, laisse échapper le liquide qui forme une flaque à ses pieds. Son travail achevé la sage-femme de la clinique Sainte-Anne, une reli- gieuse, fait remarquer au jeune père, avec un sourire en coin, que ça sent le cognac. Et de commenter, au soulagement de Marcel qui avait peur d’une engueu- lade : « C’est vraiment dommage, on aurait dû le boire ! » De ce jour, chaque année les parents de Marie-Claude ont invité sœur Josie à un repas rituel- lement couronné par un cognac. Ou plusieurs.
Des tâches qu’on assigne aux enfants, et qui ne les enchantent pas toujours, les Mimis font des jeux qui les portent dans toute la maison. Au « musée » du premier étage, elles jouent à la marchande avec les paquets de cigarettes dont elles doivent garnir les tiroirs au bistrot plusieurs fois par semaine. Bien ali- gnés dans leur boîte, en fonction de leur étiquette, les cigares sentent bon. À la cave, elles se faufilent der- rière les murs d’algérie en litrons couverts de toile d’araignées pour atteindre la réserve de pomme, dont elles ont quatre bouteilles à remplir pour le matin. Rachel tient la bouteille légèrement inclinée et
— 30 —
Marie-Claude presse des deux pouces sur le robinet de la dame-jeanne pour laisser passer le schnaps. Elles détestent cette opération, l’odeur de la pomme répan- due sur la terre battue et leurs chaussettes mouillées. Moins déplaisant, le travail dans l’autre cave, au sol cimenté, consiste à trier les bouteilles de sodas et limonades – Marcel les a déposées en vrac dans de grandes caisses – avant de les ranger à l’intention des fournisseurs qui reprennent « le vide ».
Plus grandes, les filles écopent de tâches plus fas- tidieuses. Suspendre les innombrables linges de cui- sine déclinés en diverses teintes selon leur usage. Tirer sur les lisières en les étendant afin d’éviter le repas- sage. Plier les chaussettes de toute la famille. Le dimanche, comme la fille de cuisine a congé, c’est à l’aînée qu’incombe la corvée de vaisselle, intermi- nable, parce qu’il y a des montagnes d’assiettes et de verres à laver – il faut essuyer les verres deux fois pour qu’il n’y reste aucune trace, ainsi que font les somme- lières. Mais la cadette ne perd rien pour attendre. Tous les enfants de cafetiers de la génération d’avant le lave- vaisselle partagent ce mauvais souvenir. Et puis il y a les toilettes des dames à nettoyer (au vrai, elles sont peu utilisées, les femmes n’entrant guère au bistrot) ; le patron se charge lui-même de celles des hommes. Il juge que ce n’est pas au personnel de le faire. Avec le temps, le travail devient beaucoup plus intéressant. Adolescentes, Marie-Claude puis Rachel servent au bistrot comme les vraies sommelières qu’elles rempla- cent à l’occasion. L’exercice de sociabilité se double d’une initiation économique très concrète : « Nous n’avons jamais reçu d’argent de poche, étant donné que nous pouvions le gagner avec nos pourboires. Bon moyen de connaître la valeur du franc ! »
— 31 —
L’oncle missionnaire, si loin, si près
Le fils aîné de Louis, né le 23 novembre 1913 à Fribourg, a reçu le prénom de Pierre-Baptiste. Quand il entrera en religion, il en changera selon la coutume monastique et prendra celui de Claude en mémoire, dit-il, de son stage commercial en Italie. Car il n’est pas entré tout de suite chez les cordeliers.
Admirons d’emblée les destinées tout en contraste des frères Cotting, Claude courant le monde et Marcel planté dans son bistrot. Leurs personnalités opposées n’empêchent pas la complicité fraternelle. Claude, jeune, faisait les devoirs de math de son jeune frère, qui était peu scolaire ; et Marcel, malin, allait à la gare donner les solutions à ses camarades singinois qui arrivaient par l’omnibus. Claude est plus intellec- tuel que son cadet, heureusement parce que le cursus de la prêtrise implique alors une maîtrise minimale du latin et des études de théologie. Pour autant, c’est un garçon pourvu d’un grand sens pratique et ses ambitions professionnelles ne l’aiguillent pas tout de suite vers l’état monastique. Il obtient une maturité commerciale au collège (Saint-Michel, il n’y en a pas d’autre à Fribourg pour les garçons) puis un certificat de fin d’apprentissage à la Banque de l’État, le tout en allemand, complète sa formation par une année de stage linguistique à la Swiss Mercantile School de Londres et en Italie : Milan, Naples. Et, sitôt revenu chez lui, il refait sa valise pour entrer au couvent des cordeliers.
Pourquoi pas chez les capucins, à quelques pas dans la même rue, fort populaires sur la place et fils de
— 32 —
saint François également ? Sans doute parce qu’on parle allemand chez les cordeliers de Fribourg, qui l’expédient en Allemagne pour une année de noviciat. Claude rejoint le couvent de sa ville natale en 1939. Après la guerre, il apprendra que deux ou trois seulement de ses confrères novices ont survécu aux hostilités. À Fribourg, il s’ennuie, suit les cours de l’Université mais passe le plus de temps possible avec le frère jardinier qui cultive les lopins du Grabensaal, au bord de la Sarine, en contrebas du couvent. Il ne songe qu’à partir au loin, dans une des missions que son Ordre entretient outre-mer. Mais s’il confie au maître général des Frères mineurs son rêve de rejoindre la mission de Cuba, il n’ose pas lui avouer le fond de sa motivation : les cigares.
Claude se retrouve donc en Afrique orientale pour vingt-cinq ans, le temps de voir la Rhodésie du Nord devenir la Zambie, mais pas celle du Sud le Zimbabwe. Il est basé à Chingola dans le Copper Belt, la région des mines de cuivre. Les souvenirs qu’il a publiés à son retour 8 ne soufflent mot des combats pour l’indépendance et des guerres civiles qui secouèrent ces possessions britanniques. Au demeu- rant, les anecdotes qu’il rapporte parlent joyeusement de nègres, de négresses et de négrillons. Il parlait cinq ou six langues, dont le dialecte local, avait une immense facilité de contact et une joie de vivre conta- gieuse. Il jouait de l’accordéon parmi ses paroissiens, indigènes ou expatriés, entraînait tout le monde à chanter avec lui et pratiquait un nombre incalculable de sports, histoire de rencontrer les gens là où ils sont. L’Angleterre coloniale avait confié à la mission Sainte- Thérèse, où officiait le Père Claude, une espèce de juridiction sur un village voisin, qui incluait la régie
— 33 —
des alcools. Chaque semaine une villageoise venait donc chercher auprès du missionnaire un permis de brasser – et s’empressait, rentrée chez elle, de décupler la quantité autorisée. Claude avait pris la tâche au sérieux, l’alcoolisme étant un vrai fléau dans le coin. Mais admirons encore le destin contrasté des frères Cotting. Pendant qu’à Fribourg le cadet écoule la bière avec le débit d’un fleuve, à Chingola l’aîné s’efforce de la ramener à l’étiage d’un mince ruisseau.
Le Père Claude, comme on l’appelle en famille (en fait, c’est un frère ou un oncle), fait souffler un vent d’exotisme sur les Chemins de fer, au travers d’une correspondance soutenue. On s’écrit beaucoup. Le cordelier entretient des relations épistolaires avec des gens du monde entier, il aime écrire. Chaque semaine quelqu’un de la famille reçoit une lettre. Il n’en faut pas moins. À Noël, aux anniversaires, Catherine a la larme à l’œil parce que le Père Claude est parti pour l’Afrique, rien ne sert de chanter « il reviendra z’à Pâques ou à La Trinité », dix ans se pas- seront avant qu’il retrouve le pays pour ses premières vacances, les missionnaires n’en prennent en principe que tous les sept ans.
Absent par force, il se fait représenter au Café des Chemins de fer de la plus pittoresque façon. Un jour, passant par Cape Town en Afrique du Sud, il se rend au cirque, admire le numéro d’équitation de l’écuyère Erna Hack, un dressage de haute école, et va féliciter l’artiste. Il prend un verre avec les Hack (le papa, Josef, est cornac) dans la roulotte familiale, apprend que leur prochain contrat les lie au Cirque Knie. Formidable, quand vous ferez halte à Fribourg allez voir mon frère Marcel au Café des Chemins de fer. C’est promis, Father ! Quand le cirque national,
— 34 —
le 25 septembre 1959, plante son chapiteau sur les Grand-Places, les Hack font connaissance avec la famille Cotting à l’issue du spectacle. Et le lende- main, peinard, Josef se pointe à pied aux Chemins de fer… en compagnie d’un consommateur de poids, l’éléphanteau Ma Palaj, qui va sur ses trois ans et dépasse déjà les cinq cents kilos. Tous les clients sor- tent du bistrot, verre en main, pour trinquer à sa santé sur la terrasse.
De retour en Suisse, le Père Claude prend conscience avec bonne humeur des difficultés de la réadaptation. Essayant d’expliquer à la famille com- ment on s’y prend pour jouer au golf, un sport exo- tique à l’époque, il attrape un parapluie et une balle de baby-foot qu’il s’apprête à envoyer dans un trou imaginaire quand Marcel s’interpose :
Arrête, tu vas me descendre la vitrine ! L’Africain se retourne, penaud mais rigolard :
Là-bas, quand tu envoies la balle, tout le monde t’applaudit. Ici, on me tombe dessus.
Vulcain et les dames
Jusqu’en 1962, Roger Monney a sa forge aux Chemins de fer, en réalité elle communique avec le bistrot par les caves. On ne sait trop comment qualifier cet homme : ferronnier d’art ? sculpteur ? jongleur du fer et du feu ? Le surnom quasiment posthume de Vulcain, titre d’un hommage sensible paru un an avant sa mort 9, rend mieux compte de sa puissance créatrice et de son personnage, mythique. Roger est une force de la nature, un colosse à barbe rousse, indestructible apparemment, jusque dans le
— 35 —
grand âge. « Solide comme un chêne, c’est le gland qui ne va plus très fort », déclare-t-il quand on s’inquiète de sa santé. Il est l’aîné d’une fratrie de dix- sept, ce qui échappe à l’ordinaire même dans le canton de Fribourg (la famille vit à Grolley). Roger meurt en 2015, à quatre-vingt-six ans, dans sa ferme atelier de Bellerive sur le mont Vully, ayant énormément contribué à l’écoulement des vins locaux sans attendre qu’ils soient dignes des meilleures tables. La légende veut qu’il ait dormi, une nuit, dans le tronc creux du vénérable tilleul de Morat, devant l’Hôtel-de-Ville. La chronique rapporte qu’on le trouvait endormi dans les endroits les plus incongrus, par exemple dans la fontaine que Jean Tinguely a créée en mémoire du coureur automobile Jo Siffert. Il faut dire que les cafés fermaient tôt.
Aux Chemins de fer, Roger fait partie non pas des meubles, même s’il en réalise quelques-uns pour Marcel, mais de l’immeuble, par le truchement de la mirobolante enseigne dont il l’a doté, et surtout de la famille. Il a connu le café et son patron en travaillant comme monteur chez le chauffagiste Dousse. Il s’est installé une forge sous l’un des hangars construits autour du jardin et Marcel, par amitié, lui a laissé cet espace après les transformations. La truculence, l’anticonformisme et le goût du concret les rappro- chent, mais Roger peut aller très loin dans l’extrava- gance. « Fais pas la bête ! » lance alors le patron. Certain après-midi, le ferronnier entre à vélomoteur aux Che- mins de fer, tourne à plein gaz entre les tables en voci- férant, et la machine s’arrête en éventrant un radiateur qui se met à gicler de tous côtés. Comme la Providence veille sur les poivrots, une équipe de pompiers tenant colloque au bistrot remédie rapidement aux dégâts.
— 36 —
C’est à Roger que Marcel commandera le monu- ment funéraire de son père Louis.
Les sommelières et les filles de cuisine font elles aussi partie de la famille, et ce n’est pas une formule creuse. On travaille ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble. Le soir, après la fermeture, toujours à la cuisine, on se restaure d’une saucisse de chien en se remémorant les moments forts de la journée. Mar- cel a mis un litre d’algérie sur la table, avec un gâteau. Les dames se racontent, parlent de leur vie de famille, de leur mari, des difficultés qu’elles traver- sent. « Monsieur Cotting », comme elles l’appellent, écoute, et donne des conseils souvent sollicités. Tout se partage autour de la table, les mariages, les nais- sances, les deuils, les déceptions, les bonheurs, le tra- vail et les inquiétudes. Les engueulades aussi : le suf- frage féminin, qui est acquis seulement en 1971, échauffe les esprits, Simone et Marianne se prennent de bec au point que, jusqu’à la votation, la patronne interdit le sujet.
Marcel et Marie ont le flair pour choisir des per- sonnes compétentes, sérieuses, fiables, honnêtes – très professionnelles, pour tout dire. Dans les décennies 1950-1960, ils n’emploient qu’une sommelière atti- trée et une fille de cuisine, qui logent dans la maison. Elles ont un jour de congé par semaine. L’expansion dope le recrutement des sommelières, dont les prénoms reviennent en litanie affectueuse dans les souvenirs des sœurs Cotting : Virginie, Simone, Marie-Thérèse, Esther, Marianne, Hélène qui fera lire à Marie-Claude Le Comte de Monte-Cristo, Lucie, Agnès, Micky, Cécile, Adrienne, Denise, Marie-Claire, Danielle, Babette, Anne, Christiane… Le bistrot ne repose pas seulement sur les piliers que sont les
— 37 —
clients. Le personnel fait preuve d’une grande stabilité (Virginie Piller, trente ans de maison) et le turn over n’empêche pas la fidélité : beaucoup de ces filles de la campagne, qui partent quand elles se marient, reviennent comme extras, le soir, une ou deux fois par semaine, certaines le feront jusqu’à la fin du bistrot. Un sociologue distinguerait les
« permanentes », les « tournantes » et les « extras ». Mais chacune a sa personnalité, son originalité, son statut propre. Le jour de ses quarante ans Cécile Flury, qui est veuve, reçoit une gerbe de quarante roses : de son propre chef, le jeune homme qui aide Marcel a fait une collecte auprès des clients. Léna Ber- set, dont le mari refuse d’avoir le téléphone, pro- clame : « Je le mettrai quand je serai veuve ! » Ce qu’elle fera sans tarder. Le mari de Mme Piller, qui est de service le samedi soir, vient la chercher après la fer- meture chaque semaine jusqu’à ce qu’il décède ; le couple rentre à la rue de Lausanne bras dessus, bras dessous. Désormais, c’est Marcel qui ramènera chez elle cette vaillante.
Les sommelières sont vulgairement appelées
« sommiches ». Aux Chemins de fer, ce sont des dames. Marie-Claude et sa sœur réunissent pour un souper annuel les cinq dernières sommelières en activité. Il y a de la saucisse de chien sur la table, évidemment.
— 38 —